Manifestes
Nous sommes ceux que nous attendions
Les pessimistes du climat avaient raison. Peut-on encore garder espoir? L’autrice Christina Nichol s’est tournée vers l’Inde — et sa propre histoire familiale — pour trouver des réponses.
Un jour, ma sœur nous a expliqué, à ma mère et à moi, quel était le problème de la Californie. Au Colorado — là où elle vit aujourd’hui —, il suffit de se rendre dans la ville voisine pour tomber sur des gens qui ne pensent pas comme soi. Les Californiens, eux, n’ont pas conscience de vivre dans une bulle, parce que la bulle en question est énorme. « C’est la raison pour laquelle vous avez été aussi surprises quand Trump a été élu », a-t-elle conclu. Elle n’avait pas tort.
Il a fallu que je déménage en Floride, études obligent, pour me rendre compte que discuter du changement climatique autour du souper n’était pas une activité familiale typique. Au milieu des années 90, mon père avait construit une maison en bottes de paille si efficace sur le plan énergétique qu’on pouvait la chauffer avec une simple chandelle. Nos horloges étaient alimentées à l’hydro- électricité (et finissaient toujours par prendre un peu de retard). Au mur, mon père avait suspendu une carte qu’il avait créée et qui indiquait, à l’aide d’un code de couleurs, la valeur qu’auraient les propriétés de la baie de San Francisco après la montée du niveau des océans. Ma belle-mère avait même conçu un autocollant pour voiture sur lequel on pouvait lire « Stop Global Dooming ».
Une décennie plus tard, alors que j’enseignais la science de l’environnement dans une école secondaire de Chicago, mon père était venu donner une conférence à mes étudiants. Il les avait prévenus : si l’on continuait à émettre des gaz à effet de serre, l’air se mettrait à sentir les œufs pourris; les océans, en se réchauffant, libèreraient le carbone séquestré.
J’en étais venue à croire que la vie telle qu’on la connaissait disparaitrait d’ici 2030. Mais je pensais aussi que les politiques changeraient dès que le public comprendrait la menace qui nous guettait.
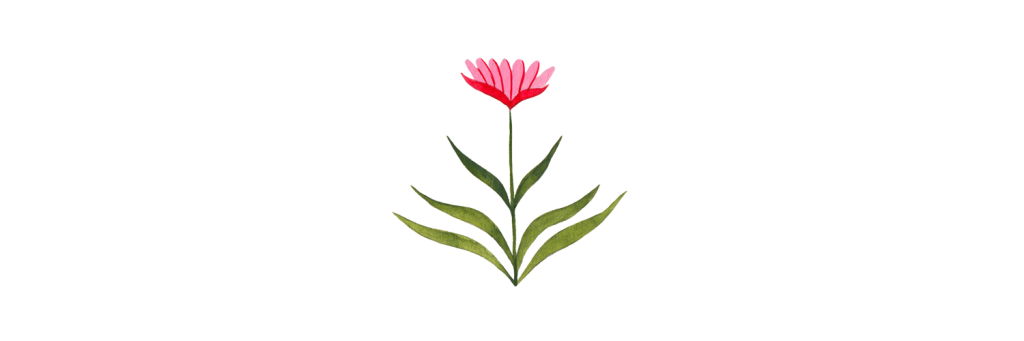
Au-delà des histoires
Une ingénieure de Mumbai, chargée de la conception de tunnels pour piétons, m’a déjà appris ceci : dans sa ville, plus de 1 600 personnes meurent chaque année en traversant illégalement des voies ferrées. Elles voient le train se diriger droit sur elles, mais elles sont incapables d’en déterminer la vitesse. Par cette analogie, l’ingénieure souhaitait expliquer pourquoi elle avait perdu foi en la capacité de l’humain à comprendre le péril environnemental auquel il fait face. En effet, si les gens ne peuvent entrevoir le danger imminent que représente le train qui fonce sur eux, comment pourrait-il en être autrement des risques associés au changement climatique ?
En janvier dernier, je suis partie en Inde. Je voulais comprendre comment la militante écologiste Vandana Shiva s’y était prise pour convaincre 280 000 Indiens de passer de l’agriculture industrielle à l’agriculture biologique. Quelles histoires leur avait-elle racontées ? Les fabricants de pesticides et de semences OGM, eux, avaient eu recours à toutes sortes d’histoires : sur leurs camions, ils avaient peint des représentations colorées d’Hanuman, le guerrier-singe; dans les villages, ils avaient clamé haut et fort que le coton Bt était une semence miracle venue des dieux, et que les pesticides étaient des potions magiques. Or, après un séjour à Navdanya — la ferme fondée par Shiva, dans le nord de l’État indien de l’Uttarakhand —, je me suis rendu compte qu’elle n’avait pas eu à raconter quoi que ce soit. Elle avait simplement contribué à la création de collectifs d’agriculteurs, où l’un pouvait observer son voisin en train de tester des méthodes biologiques sur une petite section de sa parcelle. Ces agriculteurs ne se réclamaient pas de la science derrière le réchauffement climatique. Ils disaient plutôt : « Les aliments goutent meilleur maintenant. Mes enfants sont en meilleure santé. La terre est plus fertile. On utilise moins d’eau. Je suis enfin autosuffisant. » L’évolution de leur mentalité prouvait ce qu’on savait déjà : ce qui est bon pour la planète l’est aussi pour nous.
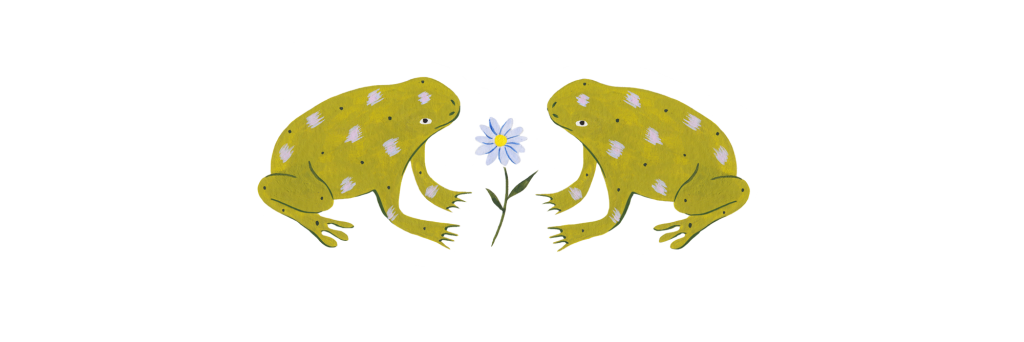
Un mariage de grenouilles
En septembre, mon amoureux, Bongjun, m’a rendu visite. Dans le Kerala, un État du sud, nous marchions sur une plage jonchée de tongs abandonnées. Nous en cherchions une paire complète afin de protéger nos pieds du sable brulant, mais, bizarrement, il n’y avait que des tongs gauches. Un mois plus tôt, le Kerala avait été frappé par une inondation dévastatrice : quelques cocotiers couchés sur le sol nous rappelaient ce qui s’était passé. De petits tas de plastique se consumaient çà et là. J’ai dit à Bongjun que je m’étonnais de trouver du calme dans ce pays, au milieu des calamités environnementales.
Bongjun a alors ramassé un bâton. Au moment où je me demandais s’il allait dessiner un cœur dans le sable et y inscrire nos initiales, il a tracé une ligne droite. « Cette moitié représente les États-Unis et le monde développé », m’a-t-il dit en pointant vers le côté sec de la plage. Puis, il a tracé une autre ligne, près de l’eau. « Ici, c’est l’Inde et le monde en développement. La marée montante représente la destruction causée par le changement climatique. »
« Ils sont les premiers à en subir les conséquences, a-t-il poursuivi. Cela explique la sensation de calme que tu ressens ici. Les gens parlent des choses importantes, des difficultés que traverse notre planète, car ils en sont témoins. L’Occident, lui, vit dans le confort et n’a pas encore besoin de faire face à la destruction; en revanche, nous la ressentons de manière latente, parce que nous sommes liés les uns aux autres de mille-et-une façons. Cela nous porte à adopter des comportements bizarres, névrotiques. »
« Mais c’est faux, ai-je répliqué : ils n’en parlent pas ici. Du moins, la majeure partie des gens n’en parlent pas. » Je lui ai fait remarquer qu’il n’existait même pas d’expression en hindi pour évoquer le changement climatique. Il y a bien un terme suggérant la « progression du climat », mais on a presque l’impression qu’il s’agit de quelque chose de positif !
Puis, je lui ai cité un article au sujet d’un mariage entre deux grenouilles, à Bhopal, où sévissait une sècheresse. L’union des amphibiens avait pour but de réveiller Indra, le dieu de la pluie. À la suite de la cérémonie, il y avait eu tellement d’inondations que des membres d’Om Shiv Seva Shakti Madal avaient cru bon de séparer les mariés.
« Je dois écrire un article pour le magazine BESIDE, ai-je ensuite confié à Bongjun. Sur mon éducation par un père adhérant à l’apocalypse climatique ET sur la manière dont je cultive l’espoir. Le problème, c’est que je n’en ai plus tellement. »
Nous avons atteint une partie de la plage où, pour une raison obscure, il n’y avait que des tongs du pied droit. Bongjun en a saisi une et l’a enfilée. « À quel moment ton père a-t-il entendu parler du changement climatique pour la première fois ? », m’a-t-il demandé.
Je n’en avais aucune idée. Soucieuse d’éclaircir la question, j’ai pris mon téléphone et lui ai écrit un courriel sur-le-champ.
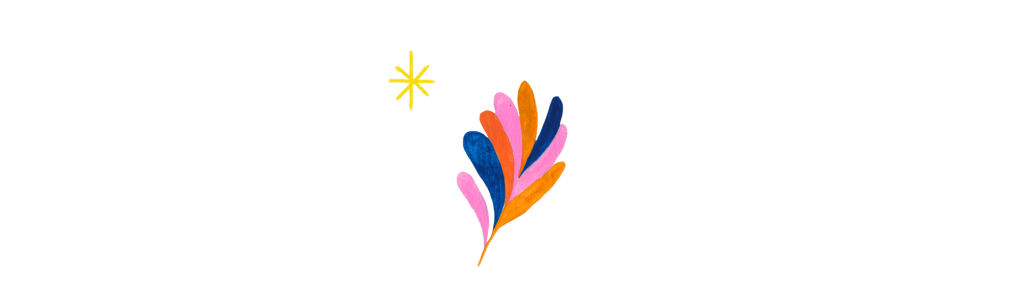
Bonne fortune
En marchant sur la plage, je me suis rappelé que le degré d’optimisme de mon père devant notre capacité à prévenir un effondrement climatique dépendait, dans une certaine mesure, de la prospérité de son cabinet d’architectes. Dans les réunions familiales, quand il se sentait riche, il citait une prophétie hopi intitulée « Nous sommes ceux que nous attendions », dont voici un extrait :
Cela pourrait être un bon moment ! Il y a un cours d’eau dont le débit est très rapide. Il est si large et si puissant que cela fera peur à certains. Ils essaieront de se retenir au bord. Ils se sentiront déchirés et connaitront de grandes souffrances. Sache que le cours d’eau a une destination. Et je dis: regarde qui est là avec toi et célèbre. […] Tout ce que nous faisons maintenant doit être fait dans le respect du sacré et dans la célébration.
Mon père ajoutait alors qu’il fallait célébrer avec encore plus de ferveur pour inclure les 10 000 générations qui viendraient après nous. Mais aujourd’hui, je crois qu’il vaut mieux mettre l’accent sur le « respect du sacré » — apprendre de nouvelles prières et traiter la Terre avec déférence. Peut-être nous faudrait-il plus de mariages de grenouilles, tiens.
Retour du côté de la plage où se trouvaient les tongs du pied gauche. Bongjun et moi avons pris place dans un café, et commandé un jus de melon d’eau et un jus de fruits de la passion. Mon père avait déjà répondu à mon courriel; j’ai lu sa réponse à mon amoureux :
« Il y a bien eu un moment, alors que je construisais la maison de St. Helena. À l’époque, on faisait beaucoup de bâtiments écologiques avec des ballots de paille, et je me suis dit que je devais comprendre à quel point cette histoire de changement climatique était sérieuse. Mes recherches m’ont donné un aperçu des évènements cosmiques miraculeux qui avaient permis l’apparition d’une planète habitable comme la nôtre. J’ai fini par développer une profonde curiosité — une obsession, même — pour le sujet. Au départ, je ne m’intéressais pas spécialement à l’aspect catastrophique et tragique de la chose. La découverte de l’harmonie de la nature s’inscrivait pour moi dans une sorte de cheminement spirituel.
C’est à la bibliothèque de Dublin, en Irlande — alors que j’examinais tous les graphiques climatiques —, que j’ai compris que le réchauffement et ses effets nous tomberaient dessus rapidement. Il est devenu évident que la menace d’une extinction massive pesait sur nous. Les connaissances que j’avais acquises m’ont donné l’assurance nécessaire pour tenter de ramener les tramways électriques dans le comté de Marin. Dix années d’efforts qui n’ont abouti à rien : nos leaders ont peur du changement. Là où il y a les connaissances et les technologies, il n’y a à peu près pas de volonté politique. Aujourd’hui, on sait que tout cela est bien réel. On sait aussi que tes neveux assisteront à l’effondrement de notre civilisation. »
Bongjun a fixé son verre vide en silence. « C’est plutôt triste comme conclusion », a-t-il laissé tomber. J’ai acquiescé.
« Il a construit la maison en ballots de paille avec ta belle-mère, n’est-ce pas ?, m’a-t-il demandé doucement. Puis, après le divorce, il a perdu la maison et il est parti en Irlande. Ç’a dû être un moment décisif : il était en quête de sens et il a commencé à étudier les écosystèmes. C’est là qu’il a pris conscience des miracles de la Terre. »
« Il s’est toujours intéressé à la nature, ai-je affirmé. Quand nous étions petits, il nous disait que le paradis, c’était la Terre, et que nous devions être aussi responsables et nobles que des dieux. Qu’il avait fallu 13,8 milliards d’années de bonne fortune et de prodigieux hasards pour créer les conditions nécessaires à la vie sur cette planète. »
Bongjun a réfléchi un instant. « C’est une belle histoire, en fait. Cette préoccupation que vous avez développée vous a été transmise par amour. Il n’est donc pas inutile d’expliquer aux gens qui nous entourent comment mieux aimer la Terre. »
Il y a une image de l’Inde moderne à laquelle je reviens constamment quand je perds espoir. C’était dans l’État central du Maharashtra, sur le bord de l’autoroute : une éolienne géante, mesurant la moitié d’un terrain de football, était décorée de lumières de Noël telle une divinité protectrice. Elle projetait une musique rassurante, semblable à celle des camions de crème glacée de mon enfance.













