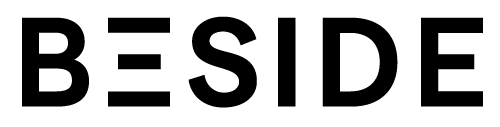Les efforts de conservation doivent tenir compte des migrations et couvrir les deux hémisphères.
TEXTE ET PHOTOS : Charles Post
Chaque automne, les pluies déferlaient sur la petite ville parsemée de séquoias que j’habitais avec ma famille, à un peu moins d’une heure de San Francisco. Parfois, il pleuvait tellement que notre cour ressemblait davantage à un étang qu’à un jardin. Il arrivait même que l’eau fasse gonfler le ruisseau qui coulait tout au bout, et qu’on y retrouve quantité de poissons — des saumons sauvages, pour être exact.
À mesure que les séquoias et moi cumulions les anneaux de croissance, toutefois, les saumons qui remontaient le ruisseau à l’automne étaient de moins en moins nombreux. En amont, l’écosystème océanique déclinait à cause de la pollution, de la hausse des températures et des éclosions d’algues; en aval, leurs habitats disparaissaient en raison du développement immobilier et des barrages qui en bloquaient parfois l’accès.
Alors qu’ils parcouraient notre ruisseau depuis des millénaires, les saumons frôlaient désormais — c’était dans les années 90 — l’extinction locale. Épuisés. Une fois les eaux de crue retirées, nous pouvions d’ailleurs apercevoir quelques retardataires, pressant leur dos courbé ou leur mandibule crochue contre la base du barrage situé un peu en amont. Celui-ci, bâti hâtivement pour limiter les débordements, empêchait les poissons pour frayer et mourir. Leur corps ne pouvait donc plus se recycler dans l’écosystème d’eau douce qui avait permis la survie de leur espèce pendant d’innombrables générations.
Par une belle journée ensoleillée d’octobre, mon père m’a aidé à escalader la clôture qui séparait la piste cyclable du ruisseau en contrebas. Armé d’un seau de près de 20 litres, j’ai attrapé l’un des saumons exténués pour l’amener de l’autre côté du barrage, où je l’ai relâché dans une zone d’eau calme afin qu’il puisse poursuivre son trajet. Ce jour-là, j’ai eu une révélation qui transformerait ma vie : j’éprouvais une véritable passion pour la faune et la nature, sans toutefois savoir comment l’incarner dans un métier. Pendant près d’une décennie, j’ai donc étudié l’écologie à l’Université de Californie à Berkeley. C’est là que j’ai pris conscience que je voulais consacrer ma vie à réaliser des films sur la protection de la nature et les métamorphoses rapides de nos paysages sauvages.
Plus précisément, j’ai eu envie de vouer mon travail aux oiseaux après ma maitrise en biologie intégrative. Je leur avais toujours été attentif : petit, je les observais avec ma grand-mère, qui veillait à ce que sa mangeoire en métal demeure bien pleine. Des années plus tard, j’avais noté le nom de toutes les espèces que j’avais pu voir à proximité de ma maison, nichée sur la péninsule de Point Reyes, à quelques kilomètres du ruisseau de mon enfance. Mon préféré était le cincle d’Amérique, une sorte de « truite volante » spécialiste des eaux vives, qui avait aussi fait l’objet de mes recherches universitaires.
Certes, dans la vie, je me présente comme un écologiste. Je m’intéresse à tout, des insectes aux saumons, en passant par leurs prédateurs. Mais si j’ai surtout étudié l’écologie des cours d’eau à l’université, les comportements et les mouvements migratoires des oiseaux façonnent ma vision du monde depuis longtemps.

Des canaris dans la mine
Les migrations sont des évènements épiques qui relient des contrées autrement éloignées. Elles existent parce que les paysages sauvages existent, des paysages qui rattachent, en quelque sorte, les forêts du nord aux prairies de l’Amérique du Sud. Chaque automne et chaque printemps, des millions d’oiseaux emplissent le ciel; il suffit de lever les yeux pour admirer le spectacle. Règle générale, ils migrent vers le sud en hiver et vers le nord en été. Certaines populations et espèces font un crochet vers l’ouest ou vers l’est, en fonction de la météo et des particularités de la nuée avec laquelle elles se déplacent. Or, il se trouve que chaque automne et chaque printemps, les rapaces qui empruntent la voie migratoire du Pacifique passent directement au-dessus de la maison de mon enfance. J’ai commencé à observer le ciel sur recommandation de mon prof de sciences du secondaire. Je n’ai jamais baissé les yeux depuis.
Les oiseaux sont les baromètres du bienêtre de notre planète, et ce, pour une raison bien simple : leur survie dépend d’un réseau alimentaire intact. L’aigle s’attaque au lapin, qui se nourrit de végétaux, lesquels ont besoin d’eau et de sols fertiles. La santé de la terre est quant à elle indissociable de la présence de taupes et de vers, de microbes, de bactéries et de champignons. Lorsque nous nous en prenons à ce réseau de liens, la trame plus large dans laquelle il s’inscrit s’affaiblit, puis finit par s’effondrer. Tout comme les requins témoignent de l’état des océans, les oiseaux sont le reflet de leurs écosystèmes : les oiseaux marins en disent beaucoup sur la mer; les faucons, sur les prairies et les forêts; et les colibris, sur les plantes en fleurs. Les oiseaux sont parmi les premiers à être affectés par la dégradation d’un écosystème. Ils sont, littéralement, les canaris dans la mine de charbon.

Des jungles bétonnées
Les animaux ne sont pas seulement présents dans la nature sauvage. Certaines espèces de rapaces se sont en effet remarquablement bien adaptées à l’environnement bâti.
Ainsi, il n’est pas rare de voir un faucon pèlerin en train de chasser des pigeons entre les gratte-ciels, ou une buse à queue rousse perchée sur un poteau de téléphone, scannant le sol à la recherche d’une souris peu méfiante. Il arrive même que l’on aperçoive des grands-ducs d’Amérique en périphérie des villes. Ils se planquent dans des bosquets d’arbres solitaires, dans une cour privée ou à proximité d’un terrain de soccer, et s’attaquent aux rats imprudents qui circulent la nuit. Leur adaptabilité leur permet de survivre sans problème dans notre monde en constante évolution. D’autres oiseaux, comme la crècerelle d’Amérique et l’aigle royal, n’ont pas autant de chance. Pour s’épanouir, ils ont besoin d’habitats et d’écosystèmes équilibrés; or, ceux-ci sont nombreux à disparaitre, à mesure que les humains empiètent sur la nature sauvage, poussés par leur soif insatiable de progrès.
HawkWatch International s’est justement donné pour mission d’empêcher leur disparition. Cet organisme insuffle une bonne dose d’espoir à une vaste communauté de scientifiques et de défenseurs de l’environnement, en cherchant à protéger la santé des écosystèmes qui abritent des rapaces. Au cours des 30 dernières années, HawkWatch International a mis sur pied 13 stations de recherche, de Washington et du Montana, au nord, jusqu’au centre du Mexique, au sud. Des centaines de membres y ont travaillé, grimpant jusqu’au sommet des montagnes pour assister à chaque migration et prendre part à ce phénomène à la fois spectaculaire et éphémère.
On dit qu’il faut un village pour élever un enfant. J’ajouterais qu’il faut au moins un hémisphère pour élever un rapace.
Je me souviens d’avoir attendu tranquillement dans la cache en compagnie de scientifiques et de bénévoles, observant l’horizon avec mes jumelles dans l’espoir de repérer une silhouette ailée. Je me rappelle que nous avons retenu notre souffle lorsque nous avons finalement reçu un signal du poste d’observation, qui nous informait du déplacement d’un aigle dans notre direction. L’équipe avait alors placé un pigeon au sol, parmi des filets japonais visant à le protéger des blessures que pourrait lui infliger l’oiseau affamé. Quelques secondes plus tard, l’aigle y était empêtré; l’équipe s’était alors employée à le sortir doucement de là pour l’apporter à la station de baguage, prendre des mesures (envergure, poids, etc.) et lui poser une bague d’identification du gouvernement sur une patte. Quelques instants plus tard, l’oiseau était libre. Le simple fait de toucher à l'une de ces créatures sauvages et vivantes vous donne l’impression de mieux les comprendre. Les données collectées par HawkWatch International permettent d’en savoir plus sur la santé des rapaces et les mouvements migratoires à long terme. Ces informations contribuent non seulement à faire avancer la science, mais aussi à influencer les politiques en faveur de la protection des oiseaux de proie — et des écosystèmes sauvages qui les abritent.

Mon film, Sky Migrations, célèbre cette histoire. Il souligne le travail des défenseurs de l’environnement décidés à faire en sorte que ces oiseaux continuent d’affluer dans le ciel, chaque automne et chaque printemps, de l’Alaska jusqu’en Argentine. Il vise aussi à rappeler que la santé de la planète — et donc celle de nos enfants et de nos petits-enfants — dépend de leur salut.
On dit qu’il faut un village pour élever un enfant. J’ajouterais qu’il faut au moins un hémisphère pour élever un rapace.
---
Charles Post a codirigé Sky Migrations avec Max Lowe et Forest Woodward. Pour réaliser ce film, paru en 2017, Post a accompagné HawkWatch International pendant une migration. Ils ont suivi des aigles royaux sur des milliers de kilomètres — une fraction de leur trajet —, juste assez pour avoir un aperçu de leur remarquable voyage.