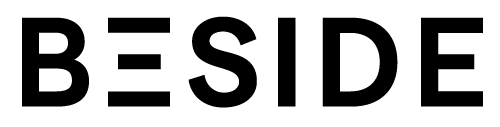Réflexions sur l’identité noire et la nature canadienne
TEXTE : Phillip Dwight Morgan
ILLUSTRATIONS : Florence Rivest
sauvage | sovaʒ |
adj.
Se dit d’un lieu inculte, peu accessible, d’un aspect peu hospitalier et parfois effrayant.
Les petits garçons noirs font de lamentables requins, du moins, c’est ce que je croyais, enfant, à Scarborough. Nous n’avons ni branchies ni rangées de dents remplaçables, et les proportions entre notre tête, notre tronc et notre queue sont complètement à revoir. C’est sans doute pour ces raisons que j’ai échoué le niveau « requin » dans mes cours de natation. Ce n’était simplement pas dans mes prédispositions. Avant cet échec, j’étais parvenu à me faire passer pour un têtard, une étoile de mer, un crapet-soleil, et même un dauphin. Hélas, devenir un requin était autrement plus difficile.
Je me revois grelotant sur le bord de la piscine en carreaux blancs du collège L’Amoreaux, trempé dans mon maillot bleu et orange qui collait comme une pellicule plastique sur mes cuisses d’adolescent, mes lunettes de natation assorties sur le sommet de ma tête. L’eau qui dégoulinait à mes pieds formait une flaque au sol, pendant que j’attendais, nerveux, le bilan de mon instructrice. Quand elle me l’a tendu, j’ai repéré deux X rouges, qui se détachaient d’une colonne de crochets verts. Apparemment, mon coup de pied fouetté était déséquilibré, et j’accusais un retard de 18 secondes sur la distance à parcourir en 2 minutes. Dépité, j’ai regagné lentement le vestiaire. Si je voulais continuer la natation, je devrais refaire le niveau « requin ».
Trois mois plus tard, après avoir échoué à nouveau, j’ai décidé, à 11 ans, de mettre fin une fois pour toutes à ma carrière de nageur et de me tenir loin des piscines. Malgré tous mes efforts, je ne parviendrais pas à développer mon instinct de prédateur.
D’année en année, la présence de la piscine L’Amoreaux, située à quelques pas de chez moi, m’est devenue de plus en plus étrange, voire surnaturelle — et les vapeurs âcres de chlore me rappelaient constamment à quel point ce genre d’endroits est singulier.
Je voulais désespérément être un bon nageur, mais j’éprouvais des problèmes de coordination. Peu d’enfants noirs fréquentaient la piscine et je me rappelle mon embarras lorsqu’un jour, des camarades avaient fait des commentaires sur mon ventre rond. En somme, ce lieu, pour moi, en était un d’aliénation. Avec le recul, je suis à peu près convaincu que mon rapport tendu avec la nature sauvage a pris naissance dans cette piscine, à l’époque où j’étais un garçon noir craintif.

Au fil des années, j’en suis venu à côtoyer d’autres enfants qui exploraient la nature avec leur famille ou leur colonie de vacances, et les mêmes sentiments d’appréhension, de peur et d’aliénation ont refait surface. L’incertitude associée à la partie profonde de la piscine se reflétait dans les vastes lacs et forêts du Canada. Les sous-bois et les fourrés denses, tout comme les plans d’eau qu’ils recelaient, pouvaient engloutir les enfants et les arracher à leur famille pour l’éternité. La façon la plus aisée et la plus sure d’échapper à ce sort, avais-je conclu, était simplement d’éviter ces lieux.
Il n’est pas difficile de comprendre comment j’en suis arrivé là. Outre mon propre inconfort face à l’eau, de puissantes forces sociétales étaient à l’œuvre. Les Noirs ont toujours été — et demeurent — bizarrement absents de l’amalgame de montagnes enneigées, de rivières, de forêts et d’animaux auxquels on accole l’étiquette de « nature » au Canada. De la même façon, nous sommes rarement représentés dans les films, les téléséries ou les livres en tant qu’aventuriers, explorateurs, gardes forestiers ou zoologistes. Nous personnifions plutôt des passants, des étrangers, des vagabonds — des individus qui figurent parfois dans cette vision de la nature, mais qui n’y sont décidément pas à leur place. La plupart du temps, nous sommes même dépeints comme des bandits ou des esclaves, irrémédiablement dépourvus des compétences ou de l’assurance requises pour évoluer dans cet environnement. À l’image du style vestimentaire que l’on nous prête, notre savoir est résolument urbain. Il y a là un message subtil, mais clair : cette absence, conjuguée aux stéréotypes que l’on perpétue, nous signale que nous sommes des bandits — des bandits dont la présence n’est, de surcroit, pas la bienvenue dans les contrées sauvages canadiennes.
Beaucoup d’entre nous ont intériorisé ce message. On ne compte plus les humoristes noirs qui plaisantent sur notre rejet du camping, de la natation, de l’escalade ou de toute autre forme de plein air. La chute de ces blagues tourne autour de l’idée que ce sont « des trucs de Blancs » — ou de celle, moins fréquente mais tout aussi problématique, qui suppose que l’évolution biologique a amené les Noirs à craindre ces activités. Par exemple, à propos de l’escalade, un humoriste noir s’interroge : « Mais pourquoi un Noir pratiquerait-il volontairement un sport qui requiert de se passer une corde autour du corps ? » Aussitôt, le public, en majorité noir, éclate de rire.
Il y a quelque chose d’insidieux dans le caractère flottant et changeant que revêt la stigmatisation de l’Autre. Cela me taraude profondément. D’un côté, l’histoire nous enseigne que les colonisateurs ont étiqueté le peuple noir comme étant « sauvage » et « primitif » pour se justifier de nous réduire en esclavage et de nous déposséder de nos terres. Notre lien intense avec le territoire constituait l’élément de base de notre oppression; il incarnait notre « altérité ». Plus récemment, les Noirs ont été coupés à nouveau du territoire, mais cette fois, la raison invoquée était la suivante : nous ne possèderions pas les connaissances requises pour vivre sur cette terre ô combien hostile et glacée. En somme, ce discours prétend que les Noirs n’ont tout simplement pas leur place dans ce qu’on appelle le Grand Nord blanc. Au cours de ma vie, cette idée a été renforcée chaque fois qu’une personne rencontrée pour la première fois me demandait : « D’où viens-tu ? », suivi de « Mais d’où viens-tu vraiment ? », lorsque « Scarborough » ne répondait pas à ses attentes.
Ce n’est qu’à 17 ans, après mon départ de Scarborough, que j’ai commencé à me pencher sur ma relation à la nature. À l’Université Trent, j’ai rencontré une population étudiante principalement blanche et rurale qui, à ma grande surprise, profitait de la nature comme je n’aurais jamais pu l’imaginer. Débordant d’histoires de camping sauvage et louant les joies des grands espaces, ces étudiants déployaient tout un vocabulaire qui tournait autour de Thoreau, du Groupe des Sept, des feux de camp et des portages. Comme vous vous en doutez, ils avaient du mal à croire que je n’étais monté qu’une seule fois à bord d’un canot — lors d’une excursion en sixième année — et que je n’avais jamais entendu parler du paysagiste canadien Lawren Harris.
Devant leur surprise, j’ai pris conscience du privilège exceptionnel et du capital culturel souvent associés à l’accès à la « nature ». En dépit du rêve romantique de ne faire qu’un avec elle, on ne peut pas omettre la réalité matérielle — l’équipement nécessaire, comme les tentes et les sacs de couchage —, qui constitue une dépense prohibitive pour certains. Cet obstacle ne limite pas seulement l’accès à la nature, mais aussi celui au repos et à la relaxation. De quelle façon es-tu allé au lac Rice ? Comment as-tu appris à pagayer ? Où as-tu acheté tes skis ou ta passe de saison ? Rarement abordions-nous ces questions. Nous ne discutions pas non plus du fait que le camping et le canot, du fait de leur ancrage dans certaines cultures, pouvaient paraitre peu inclusifs, voire ouvertement hostiles aux personnes de couleur. Pour moi, étudiant noir en histoire et natif de Scarborough, le problème n’était pas seulement que ma famille ne possédait ni canot, ni tente, ni skis, ni chalet; il résidait aussi dans le sentiment que nous n’avions aucune raison valable de revendiquer ces espaces. D’une certaine manière, peut-être pensions-nous que l’évolution nous avait effectivement détournés de la terre — et qu’elle nous avait menés des canots aux culs-de-sac.
Pour ces raisons et bien d’autres encore, j’ai décidé de me donner comme objectif de traverser le Canada à vélo. À l’époque, je voyais ce périple comme un geste clair de défiance, une façon de légitimer mon rapport à une vision particulière de la nature, qui laissait peu de place aux lignes électriques, aux terrains de basketball et aux centres commerciaux de mon enfance. Franchir le Canada à bicyclette symbolisait l’endurance, l’aventure et le contact direct avec les éléments. En secret, j’espérais, comme Thoreau, avoir une révélation personnelle lors de cette odyssée.
Même si j’avais eu l’audace d’imaginer ce voyage, je n’étais pas naïf au point de croire que je pourrais me lancer seul. Une telle expédition exigerait un niveau de confiance et d’habileté qui dépassait de loin mes connaissances et mon expérience. Elle nécessiterait aussi beaucoup d’équipement hors de portée d’un étudiant en sciences humaines — et à court d’argent.
Durant des années, j’ai fait allusion à ce projet chaque fois que je rencontrais une personne de type « plein air », en souhaitant que mes insinuations suscitent chez elle une curiosité identique à la mienne. Mais tout le monde considérait mon entreprise trop couteuse, trop risquée ou trop difficile. Mon rêve s’estompait tranquillement... jusqu’à ce que je rencontre Alex.

Je me rappelle encore ce jour : Alex et moi courrions à travers Bayfront Park, à Hamilton, en préparation d’un demi-marathon. Au milieu de notre bavardage habituel, j’ai mentionné que je rêvais de traverser le Canada à vélo, mais que je n’avais trouvé personne pour m’accompagner. Sans hésiter, Alex m’a dit : « Je vais le faire avec toi. » J’ai arrêté de courir, je l’ai regardé et je lui ai demandé : « T’es sérieux ? » Avec autant d’assurance, il m’a répondu : « Oui, quand est-ce qu’on part ? En avril ? En mai ? » Nous étions à la mi-février.
Ce weekend-là, Alex est passé à mon appartement pour commencer à planifier l’expédition. Il avait déjà fait quelques excursions d’une semaine. Pour ma part, je n’avais aucune expérience de cyclotourisme. On a dressé une imposante liste d’équipement à acheter et de tâches à accomplir. Dans mes priorités : me procurer un vélo de trekking et effectuer au moins quelques randonnées de 100 km avant notre départ.
À mesure que le grand jour approchait, j’ai commencé à avoir d’intenses visions de ma propre mort. La nuit, je me réveillais en panique, couvert de sueur. Puis, j’ai appris qu’un ami avait rêvé que je perdais la vie au cours du voyage, et je suis devenu convaincu que mes cauchemars étaient prémonitoires.

Peut-être étais-je embarrassé par le nombre de personnes à qui j’avais révélé mes plans, ou trop orgueilleux pour annuler un projet que je planifiais depuis des années, mais je restais déterminé à entreprendre le voyage. Alors que des amis et des membres de ma famille remettaient en cause ma décision, me demandant sans cesse si j’avais perdu la tête, moi, je rédigeais discrètement des lettres destinées à des êtres chers. Je les ai rangées dans mon bureau, au cas où j’y resterais.
Une semaine avant notre départ, Alex m’a rappelé plus ou moins subtilement que je ferais mieux d’effectuer au moins une sortie à vélo. J’ai donc pédalé 40 km pour me rendre à un café en dehors de la ville, acheté un croissant et un expresso, puis rebroussé chemin jusque chez moi. En arrivant devant mon appartement, je me suis dit : « Eh bien, ce n’était pas si mal », et je me suis attaqué à d’autres tâches importantes sur ma liste.
À notre premier jour, la distance à parcourir — de Vancouver jusqu’à Whistler — s’élevait à près de 120 km, principalement en ascension, avec un dénivelé positif de 700 m. Je me croyais à l’aise dans les montées; je ne l’étais pas. Je pensais savoir comment changer de vitesse; il n’en était rien. Accompagné par le cliquetis incessant de ma chaine, je me sentais comme un idiot, la descendant du plateau à l’occasion pour apaiser ma torture. À plusieurs reprises, je me suis arrêté en pleine ascension et j’ai perdu mon élan, avant de reculer et d’atterrir en bas de ma selle. J’ai sérieusement remis en question notre plan. Car en plus d’être un piètre cycliste, j’étais habité par une profonde peur de toutes les bêtes et de tous les insectes inconnus qui rôdaient dans les montagnes alentour.
Je me disais : « Qu’est-ce que je fous ici ? » Puis, dans les coins reculés du pays, j’ai gagné en confiance. C’est à prévoir quand on effectue quotidiennement 135 km de vélo, 6 jours par semaine, parfois sans croiser qui que ce soit. J’ai su qu’un profond changement s’était opéré en moi quand, après avoir failli marcher sur un énorme serpent, j’ai poursuivi mon chemin sans broncher.
Alex et moi sommes arrivés à St. John’s le 5 juillet 2012, soit 65 jours et 7 706 km après le début de notre aventure. Nous avons passé la journée à nous faire offrir des verres par des habitants du coin, désireux d’entendre des histoires sur notre périple transnational. Après nous être reposés, nous avons pris un avion pour l’Ontario. Ma famille a organisé une fête où, devant un public captif de parents et d’amis, j’ai raconté une anecdote — maintes fois répétée — à propos de ma rencontre avec un orignal mâle, sur une route du Nouveau-Brunswick. Fascinés par mes hauts faits, les invités ont passé la soirée à s’empiffrer de burgers et d’épis de maïs, en me félicitant de mon exploit. Je n’oublierai jamais leur bienveillance et leur générosité. Les mois et même les années suivant mon retour, le voisin de ma mère devait, chaque fois que je passais la visiter, m’accueillir en disant : « Bon sang ! Je n’arrive toujours pas à croire que tu as traversé le pays au grand complet à vélo. »
Pour tout dire, je n’ai pas vraiment envie de raconter les détails de mon voyage. J’ai déjà partagé mes histoires des dizaines de fois, notant quels détails embellir et à quels endroits marquer une pause subtile pour mieux piquer l’intérêt de mon auditoire. Lors des fêtes et d’autres rassemblements, ces anecdotes finement rodées s’échappaient de moi spontanément, à la moindre mention des mots « Canada », « bicyclette » ou « aventure ».
Dans un sens, notre voyage n’aurait pas pu être plus réussi. Alex et moi avions atteint notre objectif ambitieux de franchir à vélo le deuxième pays du monde en superficie, et nous étions tous deux rentrés de notre expédition avec une panoplie d’anecdotes. J’avais observé une foule de paysages, de plantes et d’animaux; désormais, mon lien avec la nature n’était plus remis en cause par qui que ce soit.
D’un autre côté, le ressassement de ces souvenirs révèle ma profonde insécurité à l’égard de ma relation avec la nature — un sentiment qui ne m’a pas lâché de la piscine aux montagnes, jusqu’à mon retour à Scarborough. D’une fois à l’autre, le fameux orignal du Nouveau-Brunswick s’est rapproché un peu plus. Pendant cinq ans, je suis resté pris : pris à raconter des histoires d’ours, de serpents et d’orignaux, pris à décrire les routes menant du désert aux sommets enneigés, pris à tenter d’inscrire ces 65 jours de vélo dans un grand récit d’exploration et d’aventure, au bout duquel le petit garçon grassouillet de Scarborough, avec son maillot et ses lunettes de natation, parvient finalement à devenir un requin et à trouver sa place.
Peut-être est-ce simplement le combat intérieur de nombreux enfants noirs nés de la diaspora. Ici, dans ce pays où nous nous sentons à la maison, les manières qu’ont nos familles d’interagir avec la nature sont rarement célébrées ou comprises. Ma grand-mère possède une ferme et un populaire restaurant en Jamaïque. Je l’ai déjà vue égorger une chèvre. Une fois, quand j’avais huit ou neuf ans, mon grand-père a capturé des lucioles pour m’aider à trouver mon chemin dans la nuit. J’étais fasciné par la haute silhouette de cet homme, un bocal de lumière à la main, tandis que nous déambulions au clair de lune. Immigrée au Canada il y a près de 50 ans, ma mère peut dire en quelques secondes quelle igname jaune acheter au marché. Le bon légume possède une teinte que mes yeux n’ont pas encore appris à discerner. Pendant des années, j’ai été incapable d’apprécier la valeur des expériences et des connaissances de ma famille. Elles ne correspondaient pas à l’idée que je me faisais d’une relation avec la nature.
Ce n’est qu’aujourd’hui, grâce à l’œuvre du temps et à près de 8 000 km parcourus dans l’espoir de m’intégrer, que je commence à discerner les problèmes qui se cachent derrière le mythe canadien de la nature, et l’éventail d’humains, d’expériences et de richesses qui s’en trouve exclus. Mon voyage se transforme dans mon esprit; les images de cols de montagne, de lacs et de champs s’embrouillent, alors que de nouvelles idées se précisent. À la base, ma traversée du Canada symbolisait la recherche d’un chez-moi, une quête d’appartenance ininterrompue au cœur d’un pays aussi hostile que gratifiant. C’était la tentative désespérée d’un petit garçon noir de Scarborough de se changer en montagne, en forêt, en aventurier, et d’entrer dans la légende. Mon odyssée ne répondait pas à mes profonds dilemmes existentiels, mais soulevait au contraire une infinité de questions. Qu’est-ce que la nature et les étendues sauvages ? Pourquoi notre relation avec ces concepts est-elle aussi tendue ? Comment pouvons-nous réconcilier nos récits d’aliénation avec notre occupation historique du territoire, qui remonte à l’époque des loyalistes noirs ? Pourquoi la nature est-elle si souvent représentée comme masculine ou féminine, vierge ou souillée, blanche ou noire ?
De plus en plus, je me préoccupe de la mise en récit de l’expérience comme manière de s’approprier le territoire volé aux Premières Nations. Je constate qu’il est futile de revendiquer son appartenance à un lieu si profondément imprégné de l’Autre, à une terre que beaucoup convoitent, alors qu’ils n’ont jamais eu — et n’auront jamais — la légitimité de la posséder.
Chaque année qui passe, je me demande combien de fois encore il me faudra relater ma traversée du Canada à mes amis et à mes collègues. Combien de fois encore ces histoires lutteront-elles pour s’échapper de ma bouche ? Peut-être aussi longtemps que l’on continuera à me demander : « Mais d’où viens-tu vraiment ? » Peut-être jusqu’au jour où j’apprendrai à nager, ou à reconnaitre enfin cette unique teinte de jaune. Mieux encore, peut-être est-ce la dernière fois.
Traduction d’un extrait de Black Writers Matter, édité par Whitney French. © 2019. Reproduit avec la permission de la University of Regina Press.
---
Phillip Dwight Morgan est un écrivain canadien dont les racines sont jamaïcaines. Ses essais, ses articles d’opinion et ses poèmes explorent les liens entre la race, la représentation, la politique et la violence d’État au Canada.