Lettres de quarantaine
Ne méritons-nous pas des vies et des morts formidables ?
Mon père n’est pas décédé de la COVID-19, mais de l’Alzheimer, à l’âge de 61 ans, dans un CHSLD de Québec. Pendant près de dix jours, sous les néons d’une petite chambre où la fenêtre s’ouvrait à peine, nous avons observé le rythme de son souffle ralentir alors qu’il mourait, pardonnez ma candeur, de faim. Nous avions refusé le gavage, puisque nous n’avions pas droit au privilège qu’est l’aide médicale à mourir. C’était la seule manière de le laisser partir. Une faille dans le système. Il m’est impossible de m’éterniser à ce sujet. Deux ans plus tard, une partie de moi git toujours dans cette pièce.
À la lumière de la crise actuelle, je tiens tout de même à exprimer ceci:
Jamais je n’aurais pu concevoir de laisser mon père mourir seul. Je ne peux qu’imaginer les contrecoups psychiques et moraux d’une telle blessure. Mes pensées vont vers ceux et celles qui traversent présentement ce deuil imprécis, sans pouvoir dire au revoir aux gens qu’ils aiment.
Il m’aurait aussi été impossible de survivre à ce processus sans l’aide précieuse du personnel soignant, qui a été à la fois bienveillant, attentionné, patient et présent — et ce, même s’il était fragilisé par ses conditions de travail depuis longtemps. Lorsque nous sommes sortis de la chambre, épuisés par nos derniers au revoir, les employés de l’étage ont formé une grande ligne devant la porte afin de nous apporter réconfort, soutien et écoute. Certains pleuraient, s’étant attachés à mon père au fil des années.
Les gens qui œuvrent en ces lieux sont des héros sans cape, prisonniers d’un appareillage égoïste et désintéressé.

Déjà, tout me semblait vulgaire dans ce système de santé qui nous heurte avec une telle bienséance que nous nous y retrouvons perdus, dupés — ou, pire encore, accoutumés aux injustices quotidiennes. C’était parfois drôle à en pleurer, ces formulaires, ces interminables processus, tout ce qui entourait la logistique du décès: mon père était vivant, puis il est mort, on l’a lavé, rhabillé, ensaché, porté, emporté, incinéré, pour qu’il soit ensuite pleuré, oublié, ranimé par les photographies, les souvenirs, les nuits blanches. Toute cette civilité fragile, cette courtoisie assommante n’offrait qu’un réconfort flou, sinon absent.
Ce système était anéanti depuis fort longtemps. Il nous aura fallu une pandémie pour en apercevoir les profondes fissures.
***
Il m’est difficile d’écrire quoi que ce soit — lettre, poème, roman — au je depuis le début de cette monstruosité. Il semble que nous formons plus que jamais un nous, unis au sein d’une grande précarité sociale et économique. Cette saleté de virus me pousse pourtant à une réflexion nécessaire sur le futur, et plus précisément sur ma mort inéluctable, et celle de mes proches. Ce sont des pensées qui me rendent nerveuse et quasi aphasique. Je suis incapable d’exprimer mon anxiété sans avoir recours à une certaine forme d’agitation ou d’agressivité.
Il faut dire que je suis nouvellement enceinte de mon premier enfant.
En février dernier, je me préparais à partir pour Québec. Catherine Dorion m’avait invitée aux quartiers généraux de Québec Solidaire pour parler de mon rapport au temps, sujet de prédilection de ma pratique d’écriture. Ce matin-là, j’ai senti que quelque chose avait changé dans mon corps. Un déclic difficile à expliquer. C’était l’instinct, accompagné, je l’avoue, d’un léger mal de cœur. Le test de grossesse maison, effectué à la vitesse de l’éclair, s’est avéré positif. J’ai immédiatement pris la route, sans que l’homme que j’aime et moi ayons eu le temps d’en discuter, de nous réjouir, de fixer ardemment ledit test pour nous assurer que tout ça était bien réel. J’ai cette tendance à vivre les moments importants en catastrophe. Je travaille là-dessus.
Cela faisait plusieurs semaines que je suivais de près l’évolution de la propagation de la COVID-19 dans les différentes régions de Chine. J’ai souvenir de m’être demandé pourquoi on ne commençait pas à se préparer, ici aussi. De m’être dit qu’on ne pourrait pas l’éviter, que ce virus allait nous engloutir, tôt ou tard. Que la désinformation nous avalerait tout crus. Que les personnes déjà malades ou en situation de pauvreté allaient être les premières à écoper. Qu’on ne parlerait plus des millions d’enfants qui meurent de faim tous les jours — déjà qu’on n’en parle pas suffisamment. Que des gens atteints de cancer allaient voir leurs traitements reportés, ou même annulés. Que ces désuètes bâtisses pour vivre-quelques-mois puis-crever allaient recevoir des milliers de corps sur les bras, que des familles enragées et endeuillées cogneraient à leurs portes, alourdissant la conscience des hauts placés et de toute personne possédant une quelconque forme d’empathie.
Et je pensais: Forcément, il nous faudra revoir nos paradigmes sociétaires. La formule usuelle va devoir s’effacer du tableau.

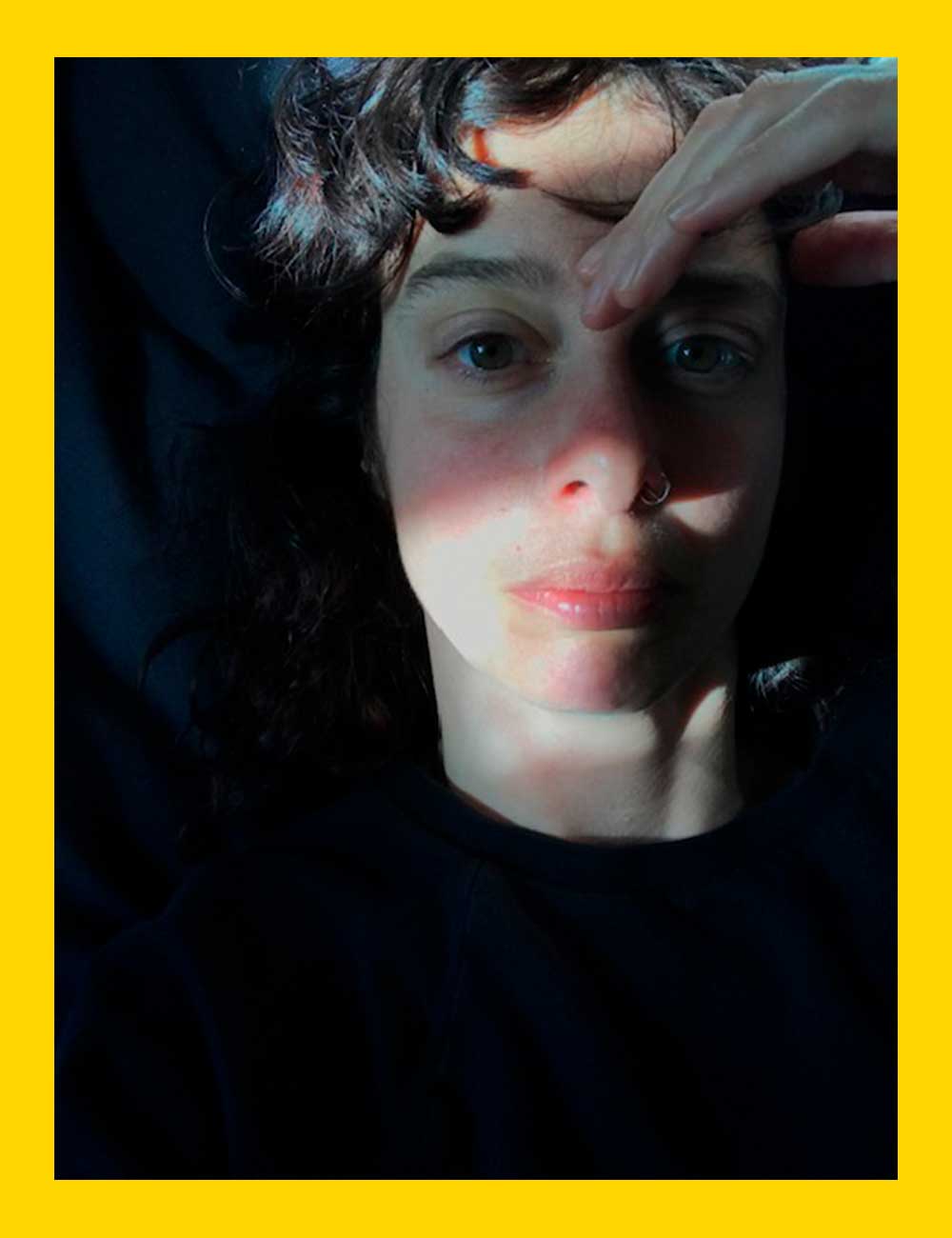
Enceinte en pleine crise sanitaire, je fais face à des contraintes doubles, voire triples. Je dois me protéger, protéger l’enfant, mais aussi préserver l’environnement dans lequel j’évolue. Même si je me considère comme privilégiée, j’ai, comme plusieurs, entrevu la possibilité de voir mon modeste monde s’écrouler. Ma santé mentale s’en trouve aussi ankylosée: j’ai dû apprendre la bonne nouvelle aux amis et à la famille par téléphone ou vidéoconférence. Je devrai d’ailleurs m’abstenir de les côtoyer jusqu’à la fin de ma grossesse, puisque le système immunitaire des femmes enceintes est affaibli — nous sommes en effet plus sujettes aux complications à la suite d’une infection. Il m’est interdit d’être accompagnée lors de mes échographies, moments d’ordinaire uniques et irremplaçables dans la vie des futurs parents. Même les rendez-vous de suivi sont espacés, quand ils ne sont pas carrément annulés.
Il y a aussi eu cette semaine fatidique où nous ne savions pas si d’autres établissements allaient emboiter le pas à l’Hôpital général juif et interdire aux femmes d’être accompagnées lors de l’accouchement. Là-dessus, les études sont catégoriques: la présence d’une personne significative est une condition essentielle au bon déroulement de la naissance. Je n’ai pas fermé l’œil jusqu’à ce que cette polémique se résorbe et que l’Hôpital général juif revienne sur sa décision, à la suite de multiples interventions de la part du Regroupement Les Sages-femmes du Québec. (Cela m’est d’ailleurs apparu très clair: il nous faudra continuer de nous méfier des politiques qui piétinent les droits des femmes, acquis au prix de nombreuses luttes par celles qui nous précèdent — ces femmes qui nous ont donné la vie.)
Même hors de ce contexte pandémique, les iniquités qui suintent du système sont si sérieuses et inexcusables qu’on croirait un mauvais rêve. Nous ne pouvons que nous sentir suffoqués par les efforts à déployer pour accéder au minimum auquel nous avons droit. La violence institutionnelle — tant pour les travailleurs que pour les bénéficiaires — gâte toute possibilité de réconciliation entre le citoyen et l’ensemble des politiques qui devraient le soutenir. On se sent irrémédiablement seuls.
Et ce sentiment de solitude est multiplié lorsque, les uns après les autres, nos droits individuels sont lésés. Ces nouvelles réalités pandémiques amènent leur lot de souffrances, et nous sommes des milliers à avoir de la difficulté à les gérer.

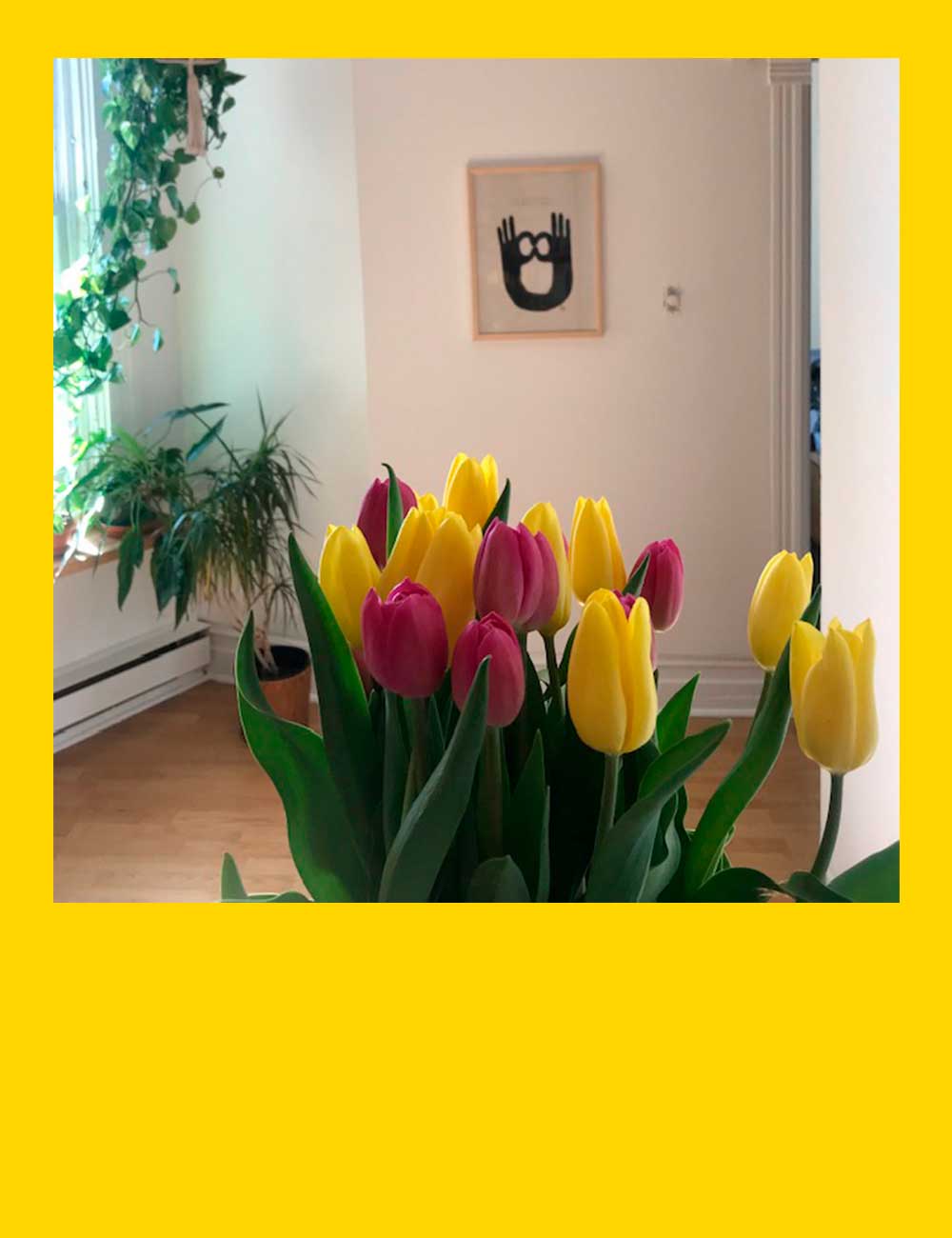
Au plus creux de la nuit, ces questions me tourmentent:
Qu’adviendra-t-il de ceux que l’on met au monde et de ceux qui s’apprêtent à le quitter?
Pourquoi ne bâtissons-nous pas de grandes maisons loin des autoroutes, vastes de verdure, de serres, et d’acres où nos ainés pourraient profiter du soleil et même de la pluie, où travailleraient des préposés aux salaires convenables — non, aux salaires plus que convenables: aux salaires justes?
Et dites-moi, à qui profitent donc ces formes «citoyennes» de travail si pauvrement rémunérées?
Que racontent-elles sur la valeur des humains qui en bénéficient? Que racontent-elles sur nous?
Est-ce qu’à la fin de cette pandémie, nos travailleurs de la santé, épuisés, verront leurs conditions revenir à cette anormalité d’auparavant?
Est-ce qu’on réussira à calfeutrer les conséquences de la crise, les risques encourus et les heures interminables auxquelles ils ont été assujettis — au-delà de simples remerciements?
Et plus largement:
Qu’adviendra-t-il de toute notre bonne et bienveillante solidarité une fois le pire de la crise passé?
Le montant de l’aide sociale représentera-t-il toujours le tiers de ce qui nous a été accordé comme Prestation canadienne d’urgence?
Comment le 1% pourrait-il contribuer à la gestion financière de cette crise?
***
Depuis que mon ventre enfle, le temps se précise et se compte maintenant en nombre de semaines. À chacune d’entre elles qui passe, la crainte de perdre l’enfant s’estompe, une curiosité nouvelle s’implante, mais je reste sur mes gardes. Il faut dire que je suis bâtie ainsi: j’ai constamment peur que tout s’écroule. Je disais plus tôt que les contraintes sont multiples.
Je suis déjà, en quelque sorte, cette mère inquiète et protectrice, qui anticipe le pire. Et le pire est là.
Moi qui n’ai jamais ressenti le vif besoin de devenir parent, je trouve un tout autre sens à l’expression donner la vie dans les temps qui courent. Je suis d’avis qu’une prochaine génération engagée saura perpétuer nos dénonciations, et je souhaite léguer toute la vulnérabilité et la fougue qui me constituent à cet être qui verra le jour au début de l’automne.
Ne méritons-nous pas tous des vies et des morts formidables?













